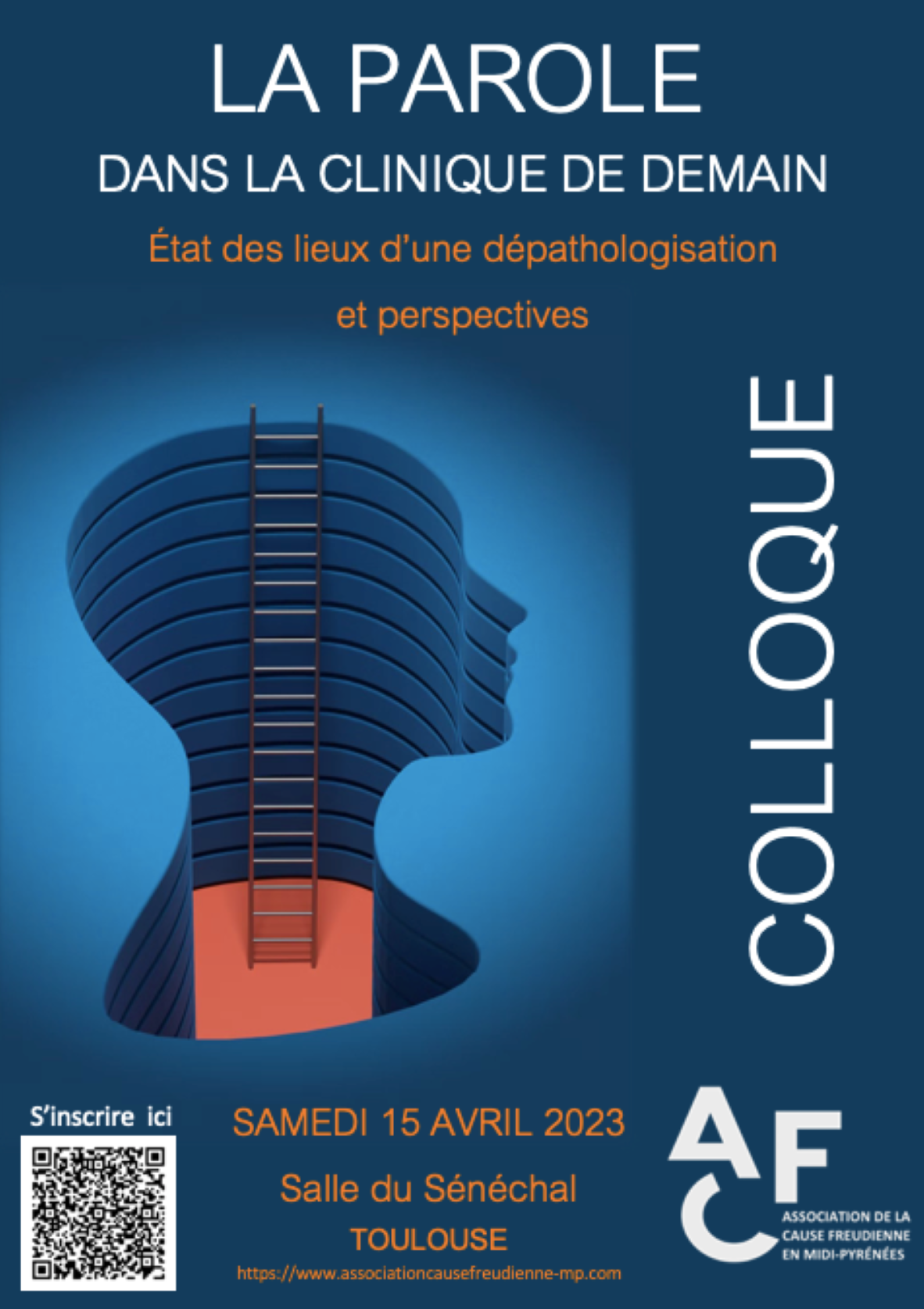Lapsus 13/04/2023
Lapsus 18 Spécial colloque - La parole dans la clinique de demain. Etat des lieux d'une dépathologisation et perspectives
Jean-François Cottes, vous êtes psychanalyste, membre de l’École de la Cause freudienne et de l'Association Mondiale de Psychanalyse. Vous êtes l'un des invités de l'ACF en Midi-Pyrénées pour son colloque du 15 avril prochain "La parole dans la clinique de demain. État des lieux d'une dépathologisation et perspectives." et plus particulièrement dans une séquence qui porte le titre LE MIRAGE DU "TOUT-NEURO". Nous vous remercions de nous aider à vous présenter au public qui viendra vous écouter ce jour-là, en nous parlant de votre pratique clinique actuelle en institution.
Jean-François Cottes : J’occupe un poste de psychologue à temps partiel dans un établissement médico-social public recevant et accompagnant de jeunes Sourds. J’y assure les fonctions cliniques directes auprès des enfants adolescents et familles, et aussi l’animation du travail clinique avec les équipes éducatives et rééducatives et enfin les interventions institutionnelles auprès de la direction de l’établissement. Pour ces interventions je m’oriente de la psychanalyse d’orientation lacanienne.
Cela fait 25 ans que j’interviens auprès des jeunes Sourds, cela a été une véritable rencontre pour moi. J’y ai découvert comment la LSF est authentiquement une langue à part entière et permet au sujet d’émerger en tant que tel dans le champ du langage par la mise en jeu de la fonction de la parole. C’est pourquoi je me suis formé à la Langue des Signes Françaises pour pouvoir accompagner la subjectivation de ces sujets.
Comme ailleurs nous assistons dans ce secteur à l’offensive du neuro. C’est particulièrement le cas pour les enfants présentant ce que le DSM appelle les Troubles du langage qui sont aussi accueillis dans l’Etablissement, mais de plus en plus aussi pour les Sourds. Cette offensive neuro concerne non seulement l’évaluation neuropsychologique et psychométrique mais aussi les prises en charge. Il y a une tendance très nette à substituer cette approche à l’approche psychanalytique qui est partagée non seulement par plusieurs psychologues mais aussi par des éducateurs qui se forment à la Section clinique notamment.
Mon intervention au colloque prendra racine très directement sur ma pratique en institution.